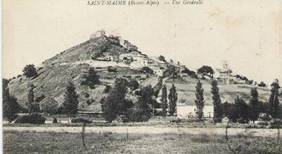
Saint Maime :
C'est un petit village, posé sur une hauteur, situé dans la vallée du Largue près de Forcalquier et encore plus près de Mane. Son nom viendrait de Sanctus Maximus, évêque de Riez.
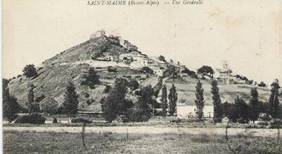
Le territoire était possession des comtes de Forcalquier puis des comtes de Provence. Un des principaux titres de gloire du bourg fut d'avoir accueilli les quatre filles de Raimond Bérenger V, comte de ces lieux qui toutes les quatre furent reine : Marguerite épousa St. Louis (Louis IX), Eléonore fut mariée avec Henri III d'Angleterre, Sancie devint reine des Romains par son mariage avec Richard de Cornouailles, frère du roi d'Angleterre et Béatrice fut reine de Sicile et de Naples en épousant (1246) Charles I d'Anjou (frère de St. Louis) après le décès de son père (1245), voici pour l'histoire mais la légende dit que Raimond Bérenger V y aurait fait élever ses filles ; il est beaucoup plus vraisemblable qu'elles n'y ont jamais mis les pieds. Voici ce qu'en dit Jean-Yves Royer dans son livre « Forcalquier. »
A dire vrai on associe souvent ces quatre dames non pas à Forcalquier véritablement, mais à Saint-Maime et à son ch â teau, où on les fait tantôt naître, tantôt se marier, voire les deux à la fois. Sur quelle base historique reposent ces affirmations? Sur rien : le château de Saint-Maime n'appartenait nullement à Raimon Berenguier, les comtes de Forcalquier en ayant fait don en 1168 aux Hospitaliers. Les seigneurs locaux avaient pu ensuite remettre plus ou moins la main dessus (Bertran et Laugier de Saint-Maime y sont coseigneurs en 1217), avant que la communauté elle-même n'en dispose, pour laisser finalement la place à la maison d'Agoult au XIV 0 siècle. Quant aux mariages des filles Berenguier, on soit parfaitement où ils ont eu lieu : à Sens, à Canterbury, à Aix et à Lyon. Alors pourquoi Saint-Maime? La raison ne manque pas de piquant.
Il y avait autrefois au confluent de la Laye et du Largue, au-dessous de Saint-Maime, un quartier qu'on appelait La Cour. Le sens d'un tel toponyme, très banal en Provence, ne pose aucun problème: en campagne, le mot de cour d é signait un enclos à moutons. Mais ignorant ce fait, un érudit local du siècle dernier s'imagina qu'il s'agissait de quelque cour seigneuriale et, se demandant laquelle on pourrait situer en ce lieu, songea tout naturellement à celle de Raimon Berenguier, seul prince un tant soit peu connu dont la présence soit attestée pas trop loin. Et voilà comment D.J.M. Henry en vint à écrire en 1818, dans ses Recherches sur la géographie ancienne et les antiquités du département des Basses-Alpes, le passage suivant :
"Le village de St. Mayme, bâti sur une éminence vis-à-vis de celui de Dauphin, possédait, sous les Comtes de Forcalquier, un vaste château dont il ne reste plus qu'une tour en ruine. La tradition conserve le souvenir de quatre Princesses qui y furent élevées, et qui épousèrent quatre Souverains (Les rois de France, d'Angleterre et d'Aragon -sic- et le roi de Naples, Charles 1 ° , frère de St. Louis ; elles étaient filles de Raymond Béranger.) Une partie du terrain qui avoisine ces ruines, retient encore les noms de jardin de la cour, vigne de la cour, pré de la cour." Ses successeurs se contentèrent d'abord de recopier ces lignes mot à mot, puis se mirent à broder là dessus, et on en arriva à multiplier naissances et mariages royaux dans une tour et une chapelle qui, assurément, n'en demandaient pas tant. Dans cette affaire, on a donc confondu bêtes à laine et têtes couronnées. Cela dit nous sommes ici tout près du château de Sauvan, "le petitTrianon de la Provence ". Et si autour du Trianon versaillais, une reine jouait à la bergère, auprès du provençal les brebis peuvent bien jouer aux reines...
Quant au château, là où le comte de Provence aurait fait élevé ses filles, il ne reste que des ruines de la base de ses murs et une tour polygonale, que l'on pense être le donjon. Au cours des guerres de religion, il fut occupé par un ligueur, le capitaine Vernet qui apporta, avec ses troupes, la désolation dans le pays ; surtout qu'en face, le village de Dauphin était inféodé au roi de France ; voisinage qui donna naissance à un dicton local : « San Maime e Dauphin dansoun dou meme tambourin ».
Au XIV° s., le pays dépendait de la vicomté de Reillanne et était propriété de la famille Agoult puis au XVI° s., on le retrouve dans le giron du marquisat d'Oraison. En 1654, le pays de St. Maime, avec Dauphin, devint une baronnie au profit d'Antoine d'Albertas que le roi, ainsi, récompensait ainsi pour services rendus à la couronne. Puis le bourg se nomma « Mont Libre » à la Révolution.
Tout proche du château et dominant le village se trouve la chapelle Sainte Agathe, vierge et martyre, qui dut être édifiée au XII° s., elle est petite mais haute, plus élevée que ce qu'on a l'habitude de voir ; elle semble lui être contemporaine, les pierres qui la constitue sont les mêmes que celles du donjon. Son abside fut presque entièrement décorée de fresques comme le laisse supposer les traces qu'on a pu relever.

Une lointaine tradition situe entre St. Maime et Dauphin, au lieu dit « les Encontres » (ferme fortifiée de l'époque de François I, sur l'ancienne route de Mane) une bataille entre Romains et Celtes (j'ai failli écrire « Gaulois ») ; en 1793, un agriculteur retournant son champ découvrit 1500 squelettes et leurs armes.
Son sous-sol est riche en gypse, lignite surtout, potasse et schiste bitumeux, il fut à l'origine d'une exploitation industrielle qui donna naissance à la fin du XIX° s. à une cité minière au sud du village dont on peut voir encore des pavillons ; un musée de la mine explique cette époque ; toute activité cessa en 1949.
Il reste à parler des diamants de St. Maime. On les trouve sur une colline en face du village, Eugène Plauchud en fit un livre : « Lou diamant de St. Maime » qui met en scène une cour d'amour à l'époque moyen âgeuse. Là, on peut ramasser des petits cristaux de quartz qui ressemblent étrangement aux bijoux faits par ces pierres précieuses. Ils étaient à la mode à la cour de Louis XIV, dit Patrick Ollivier-Elliot dans son livre : « Pays de Lure, Forcalquier, Manosque et de Jean Giono » Edisud, 2000. Bouyala d'Arnaud quant à lui parle dans son livre « Histoires de la Provence » 1965, du maréchal du Muy qui était comte de saint Maime et se montra un jour, à la cour de Louis XVI, habillé de pied en cap d'un vêtement parsemé de ce que l'on croyait être des diamants et qui, en fait, n'était que du quartz habilement taillé.
Dernière précision, en 1924, une monographie, que je ne possède malheureusement pas, fut consacrée à ce village.

(ICI) Le roman-poésie (en français) d'Eugène Plaucud : "Le Diamant de Saint Maime".
NOTICE HISTORIQUE ET LITTÉRAIRE SUR LES QUATRE FILLES DE RAYMOND-BÉRENGER IV
par
CYPRIEN BERNARD.
extrait de : Annales des Basses-
Alpes. Bulletin de la
Société scientifique et
littéraire des Basses-
Alpes, tome XV, 1911-1912

Il existe dans le canton de Forcalquier, à quelques
kilomètres au sud du village de Mane, une luxuriante
contrée, très fertile, arrosée par trois cours d'eau qui
donnent à ce terroir la fraîcheur et de riches moissons.
Cette contrée, qui, à l'époque gauloise, appartenait aux
tribus des Cavares et des Voconces, vit les armées romaines
envahir son sol vers l'an 125 (avant J.-C), à la suite
de la défaite de Teutomal, roi des Saliens.
Les Saliens furent vaincus, leur pays conquis, et le
consul C. Sextius Calvinus, près d'un endroit où il avait
remporté une victoire considérable et où se trouvaient de
nombreuses sources froides et chaudes, bâtit une ville à
laquelle il donna son nom Aquae Sextioe (Aix), la première
que Rome ait fondée au delà des Alpes.
Le roi des Saliens, Teutomal, s'était réfugié chez les
Allobroges. Il fut redemandé par le consul romain Domitius
Aenobarbus, qui, sur le refus de le lui livrer, leur
déclara la guerre.
Teutomal, privé de ses Etats, réclama le secours des
peuplades qui lui avaient offert l'hospitalité ; il redescend
en Provence, à la tête d'une nombreuse armée, et cherche
à reconquérir son royaume. A la suite de ses troupes, se
trouvait un barde, qui, dans un chant barbare, célébrait
les louanges du roi des Allobroges, vantait sa puissance,
sa noblesse et ses vertus.
La tradition veut que les deux armées se soient rencontrées, le 10 août 121 (avant J.-C.), dans la plaine située
entre Mane, Dauphin et Saint-Maime, sur les bords du
Viou, de la Laye et du Largue, au lieu appelé les Encontres
et où passe le chemin Seinet. Le choc fut terrible; la
victoire resta aux Romains.
Les noms topiques : champ prélien (campus prelii), champ féroux (campus ferox), champ des encontres (campus concursus), que conservent divers quartiers de
cette plaine, les débris de chariots, d'armures qu'on y
trouve et la quantité de squelettes découverts au domaine
de Saint-Clair attestent la violence du combat et la
véracité de cette assertion.
Certains historiens supposent que cette sanglante
bataille, qui fut un désastre pour nos ancêtres, alliés aux
Saliens et aux Allobroges, serait un épisode de la lutte de
Marius contre les Ambrons et les Teutons.
Le nom de Roche Amère, demeuré au gigantesque
rocher de Villeneuve, qui domine le Largue, semble être
un souvenir de cette mémorable journée.
Au sud de cette plaine historique, on aperçoit, au
sommet d'un mamelon rocailleux, abrupt, où croissent des
plantes aromatiques et quelques amandiers sauvages et
où la brise matinale apporte, à chaque printemps, les
mille senteurs des fleurs de la montagne du Luberon, les
respectables vestiges d'un château moyenâgeux auquel
sont contiguës une chapelle romane, bien conservée, et les
ruines d'une tour heptagonale dont les pans rongés par
les années et les âpres baisers du vent montrent aux
archéologues et aux visiteurs leur aspect sévère et dénudé.
Le superbe aqueduc romain de Tatet, dont on peut
admirer encore quelques restes imposants, amenait
dans ce domaine comtal, après un parcours de plus d'une
lieue, les eaux de la légendaire source de Font-Beillanne. Raymond-Bérenger IV, fils d'Alphonse II, de Barcelone,
comte de Provence, et de Garsende de Sabran,
comtesse de Forcalquier, réunit sous son sceptre ces deux
comtés souverains, comme héritier de son père, en 1209,
et donataire de sa mère, le 20 janvier 1214.
Cette réunion de la Haute Provence à la Basse ne fût
pas une absorption, car chacun des co-Etats garda ses
statuts, ses coutumes et ses privilèges. Dès le jour que
Garsende de Sabran, eut confirmé, au palais d'Aix, les
libéralités faites à son fils, c'est-à-dire la donation de tous
les droits qu'elle possédait dans le comté de Forcalquier,
la ville de Forcalquier cessa de porter le titre de capitale
de la Haute-Provence, et, chose singulière, au moment où
elle perdit son autonomie, elle devint le siège d'une Cour
brillante. Garsende, en effet, simple régente à Aix, obligée
même de partager cette régence avec un beau-frère, était,
au contraire, à Forcalquier, souveraine exclusive et de
par son droit personnel. C'était là, d'ailleurs, le manoir
des siens. On s'explique pourquoi elle transporta si souvent
au château de Forcalquier ou à celui de Saint-Maime
la Cour charmante et poétique qui l'entourait. A Saint
Maime, les troubadours, qui chantaient l'amour de la
Provence, les beautés de leurs châtelaines et les gloires de
leurs souverains, affluèrent.
C'est là, peut-être, qu'elle entendit les sirventès et les
coblats que lui chanta Elias, de Barjols ; là, qu'elle rima
des vers à Guy, de Cavaillon, car elle fut un Mécène, et
de ses châteaux féodaux ne sortaient pas toujours des
chevaliers bardés de fer, la lance tendue pour la mêlée
sanglante des batailles ; quelquefois, au contraire, le pont-levis
s'abaissait pour y laisser entrer l'art et la poésie et
y voir créer ces élégantes réunions poétiques appelées
Cours d'amour, sur lesquelles l'ardente imagination des
Chroniqueurs du moyen âge s'est toujours enthousiasmée. Les Cours d'amour formées sous son inspiration réunissaient,
avec les plus illustres troubadours ou trouvères,
les gentes et nobles dames dont les noms, inscrits au livre
d'or de la chevalerie, resteront une des plus pures gloires
provençales, telles: Alaëte, d'Ongles ; Adélaïs de Mévolhon,
de Malcor ; Tibors, de Séranon ; Uguette de Sabran-
Forcalquier ; Phanette de Gantelmi; Bérengère, de Feissal
Isabelle Bourillon ; Philippine de Porcelet ; Adalazie de
Signes ; Bertrane de Romanil ; temps chevaleresques où
galants preux et troubadours traduisaient, en sirventès,
tenons, pastourelles et stampides, aux dames, leurs
hommages de respect, d'admiration et de fidélité.
Les trouvères, ces anciens poètes provençaux qui
surent conserver le goût naissant de la poésie et perpétuèrent
l'amour de la politesse, si enviée à la France, y
étaient admis gracieusement et, aux sons plaintifs de
leurs mandores et de leurs sirventès, ils égayaient l'aimable
châtelaine, qui, accoudée au balcon de pierres de la
fenêtre ogivale, penchait son front pensif que la lune
auréolait, quelquefois, d'une blanche et pâle clarté.
C'est dans ce pittoresque séjour que grandit son fils
Raymond-Bérenger, là qu'il se prit d'amour pour sa bonne
capitale de Forcalquier, qui lui dut de nouvelles franchises
municipales, car elle reçut de ce souverain de nombreux
privilèges.
L'acte qui les concéda porte la date des ides de février
1217. Cette ordonnance fut rendue devant l'église Notre-
Dame, le comte siégeant sur l'escalier qui conduisait au
clocher. La disposition finale porte : Actum in castro
Forcalquerii ante ecclesiam Beate Marioe et comes in
scalariis quo ascenditur ad cloquerium (1).
(1) Archives municipales de Forcalquier, registre des privilèges, f°s 11 et 45.
Raymond-Bérenger IV, qui se maria, en 1219, avec la
charmante Béatrix, fille de Thomas, comte de Savoie. régnait à Aix au milieu d'une Cour fastueuse. Quelques
temps après ce mariage, sa mère, Garsende, se fit religieuse
et devint la bienfaitrice du monastère de la Celle, près
Barjols.
La ville de Forcalquier fut une des villes de Provence
que Raymond-Bérenger favorisa le plus. Il commença la
construction du couvent des Cordeliers, continua celle de
l'église du Bourguet et montra, toute sa vie, une affection
profonde pour le pays de sa mère.
Il habitait, l'été, le château de Saint-Maime, où, d'après
les traditions locales, naquirent ses quatre filles et y
passèrent presque toute leur jeunesse ; elles étaient
pleines de grâces, de coeur et d'esprit; leur histoire devrait
être écrite en lettres d'or dans les annales provençales.
Elles filaient le chanvre et le lin soyeux, et, l'été, le lendemain
d'un orage, elles allaient chercher, dans les collines
ombrageuses de l'Hubac, des diamants que le gel et le
dégel, en soulevant la terre, avaient fait sortir de son sein
et qui, lavés par la pluie, devenaient, aux rayons du soleil
levant, des joyaux étinelants (1).
(1) Les diamants de Saint-Maime n'ont, des diamants, que le nom. Ce sont
de très petits cristaux de quartz (cristal de roche) de forme rhomboédrique,
représentant des prismes hexaèdres terminés, à leurs extrémités, par des
pyramides à six faces. Ils sont admirablement cristallisés et d'une transparence
parfaite. — EUG. PLAUCHUD.
M. le marquis Charles de Gantelmi d'Ille raconte, dans son intéressante Géologie de la commune de Volx, que « l'illustre maréchal du Muy, comte de
Saint-Maime, réunissait aux plus brillantes qualités militaires une profonde
modestie et une sincère piété ; sobre pour lui, ennemi du faste, prodigue dans
la charité, il refusa à diverses reprises le ministèrede la guerre, que Louis XV
lui avait offert, parce qu'il aurait été forcé de paraître à la Cour, dont la
corruption l'effrayait. Enfin, contraint par les instances du nouveau roi, il
accepta en 1774 et se vit dans l'obligation d'aller aux fêtes du château. La
première fois qu'il s'y montra, le maréchal était constellé de diamants de la
tête aux pieds. On s'entretint beaucoup de cette profusion, déplacée chez un homme d'un pareil caractère. Le roi lui-même on fut surpris et parut
mécontent. Le comte du Muy, s'apercevant de la froideur que lui témoignait
Louis XVI, en demanda la cause; puis, allant vers le monarque, il le supplia
de vouloir bien l'autoriser à déposer à ses pieds uu boisseau des diamants qui
faisaient l'admiration de sa cour. Il ajouta, pour dissiper la surprise du roi,
que ses fermiers en recueillaient à pleines mains sur ses terres de Roulière, à
Saint-Maime. Ces jolis cristaux eurent, dès ce moment, une grande vogue;
puis, comme tous les objets soumis aux caprices de la mode, ils furent
délaissés. »
Leur bonheur consistait à répandre des bienfaits autour
d'elles, à soulager l'infortune, et l'amour et le respect de
leurs sujets étaient leur récompense.
La Cour de leur père, qui était le rendez-vous des
grands seigneurs provençaux, était renommée par sa
politesse, sa galanterie et l'étude du Gaï Saber.
L'aînée, Marguerite, qui naquit en 1221, épousa, à Sens,
le 27 mai 1234, Louis IX, roi de France, ce roi qui, en
toute circonstance, montra, avec une piété ardente, la
modération d'un saint et d'un politique avisé. Marguerite
de Provence fut couronnée dans la cathédrale de
Sens, le jour de l'Ascension, le lendemain de son mariage.
Son entrée à Paris fut triomphale. C'était la joie et le
bonheur qui entraient au foyer royal. Raymond-Bérenger
lui donna en dot six cent mille livres. Romée de Villeneuve,
le conseiller du comte de Provence, sut fort bien
répondre à celui-ci, qui trouvait la somme un peu élevée :
« Laissez-moi faire, Comte ; si vous établissez hautement
votre ainée, vous marierez bien plus facilement les trois
autres. »
L'avenir lui donna raison.
Une poétique légende raconte que le troubadour Catelan,
amoureux de la princesse Marguerite de Provence, la
suivit à Paris pour lui demander si elle avait retrouvé,
dans les brumes de la Seine, le ciel bleu et les fruits d'or
de son pays natal. En des strophes d'une magnificence merveilleuse, il
compare la terre du soleil à celle des brouillards. Mais,
arrivé à Paris, le poète est assassiné par des voleurs
dans le bois de Boulogne, au lieu qui a retenu le nom de
Pré Catelan., et, dans ce pré arrosé de son sang, les pâles
filles de l'Ile-de-France cueillent, à chaque printemps, la
pervenche aimée du troubadour.
Frédéric Mistral a fait, à ce sujet, une exquise ballade,
dont il donna la primeur à l'Escoro des Aup, dans la
félibrée de Saint-Clément-les-Volx, le 21 septembre 1879,
ballade que l'immortel auteur de Miréio a su revêtir des
plus riches couleurs.
Marguerite de Provence avait été enseignée et doctrinée
en sens et courtoisie et en toutes bonnes moeurs
dès le temps de l'enfance, dit le chroniqueur Guillaume
de Nangis.
En 1238, une armée prodigieuse de Sarrasins envahissait la Terre Sainte et remportait à Gaza une grande
victoire où périrent les cinq cents templiers qui restaient
en Palestine. Louis IX était presque mourant, quand ces
tristes nouvelles parvinrent en Europe ; mais à peine était-il
remis, malgré la vaste ligue formée contre lui, et obtenant
du pape Innocent IV la permission d'aller combattre les
Infidèles, il partit pour l'Egypte, projetant d'y fonder une
importante colonie et pouvoir, par la suite, conquérir la
Terre Sainte ; sa femme, la belle reine Marguerite, l'avait
suivi. Les débuts de la croisade ne furent point heureux.
Saint Louis, dont les troupes souffrirent beaucoup des
feux grégeois que leur lançaient les Sarrasins, fut fait
prisonnier malgré la victoire, à Mansourah, près de
Damiette.
Il y avait trois jours que la reine Marguerite avait
appris la captivité de son mari, lorsqu'elle accoucha d'un
fils nommé Jean, qu'elle surnomma Tristan.
Elle faisait coucher à ses pieds, pour sa sécurité, un
vieux chevalier âgé de 80 ans. Peu de temps avant d'accoucher, elle s'agenouilla devant
lui et lui requit un don ; le chevalier le lui octroya, et la
reine lui dit : « Je vous demande, par la foi que vous
m'avez baillée, que si les Sarrasins prennent cette ville,
que vous me coupiez la tête avant qu'ils me prennent », et
le chevalier répondit : « Soyez certaine que je le ferai
volontiers, car je l'avois pensé que je vous occirois avant
qu'ils vous eussent prise. "
Marguerite de Provence fut une reine héroïque, une
excellente conseillère, un précieux auxiliaire, et ce fut
d'après ses sages conseils que les Simon de Montfort, qui
avaient fait tant de mal à son pays, quittèrent la Cour de
France et passèrent en Angleterre.
La deuxième fille de Raymond-Bérenger, Eléonor (1),
devint l'épouse, eu 1233, d'Henri III, roi d'Angleterre ; ce
mariage fut célébré, dit la chronique, en grande solennité,
dans la coquette chapelle romane du château de Saint
Maime.
(1) Dans un toast porté au banquet félibréen du 18 septembre 1910, lors des fêtes de l'inauguration du monument de Berlue, à Forcalquier, le R. P. Xavier de Pourvières démontra que le roi actuel d'Angleterre, Georges V, descendait d'Eléonore de Provence, fille de Raymond-Bérenger IV.
Les seigneurs provençaux y assistèrent.
En 1279, les reines de France et d'Angleterre, Marguerite
de Provence et Eléonore, à qui était dû le montant de
la dot qui leur avait été constituée par Raymond-Bérenger,
obtiennent de l'empereur Rodolphe de Hapsbourg l'investure
de la Provence. Mais, par accord intervenu, l'année
suivante, entre Rodolphe et Charles Ier, celui-ci est maintenu
dans la possession des comtés de Provence et de
Forcalquier, à titre de fief impérial, sous les redevances
et charges ordinaires, moyennant l'abandon qu'il fait du
vicariat de l'empire de Toscane et de la sénatorerie de
Rome, qui lui avaient été conférés.
La troisième, Sancie ou Sanche, épousa, en 1242, Richard, duc de Cornouailles, qui fut plus tard ploclamé
roi des Romains.
On avait d'abord projeté pour elle un mariage auquel
poussait une raison d'Etat : depuis longtemps, le comte de
Toulouse, Raymond VII, était en désaccord avec le comte
de Provence. Jacques d'Aragon, cousin de ce dernier, voulut
les réconcilier par un mariage et fiancer Sanche avec le
comte de Toulouse, qui était veuf ; mais ce mariage ne se
fit pas, parce que le frère de saint Louis avait déjà
épousé la fille du comte de Toulouse, avec cette clause au
contrat que, s'ils n'avaient pas d'enfant, le comté de Toulouse
serait uni à la couronne de France. La reine Marguerite
avait empêché cette alliance, craignant que le comte
de Toulouse n'eût d'enfants de ce second mariage, et
Marguerite de Provence fit épouser à sa soeur Sanche
Richard, comte de Cornouailles, frère du roi d'Angleterre.
L'union s'accomplit à Aix, en grande solennité. Raymond
VII, comte de Toulouse, ne s'était pas découragé par
cet insuccès et devint l'ami des Provençaux.
Jacques, roi d'Aragon, voulut faire épouser l'héritière de
Provence, Béatrix, par son fils, Pierre d'Aragon ; mais les
Etat généraux, tenus à Aix en août 1245, préférèrent un
prince français aux princes étrangers. Aussi il est tout à
l'honneur du comte de Provence d'avoir uni à sa famille
deux grands princes et deux grands rois.
Dès le 20 juin 1238, dans le couvent des Cordeliers, à
Sisteron, le comte de Provence avait testé en faveur de
Béatrix, la gento cacoio, sa plus jeune fille, à l'exclusion
expresse des trois aînées et avec clauses de substitution,
à défaut de Béatrix, en faveur de son cousin Jacques,
roi d'Aragon.
Ce testament indiquait nettement, de la part du comte,
le vif désir de sauvegarder l'autonomie de la Provence et
probablement de marier Béatrix à l'héritier de la dynastie
aragonaise.
Romée de Villeneuve, ministre général de tous les Etats de Raymond-Bérenger IV, le comte vivant, devint, avec
Guillaume de Cotignac, administrateur de la Provence,
après sa mort, en qualité d'exécuteur testamentaire et de
tuteur de Béatrix, qu'il voulut marier à Charles Ier
d'Anjou.
Ses désirs reçurent une solution heureuse, et l'héritière
du comte de Provence, Béatrix, se maria, après la mort
de son père, avec Charles Ier d'Anjou, frère de saint Louis,
roi de France.
Ce mariage fut célébré à Lyon, le 30 janvier 1246.
Romée de Villeneuve avait lui même conduit Béatrix à
Lyon, où résidait le pape. Charles d'Anjou l'y attendait.
Innocent V bénit leur union ; puis les nouveaux époux
vinrent en Provence recevoir le serment de fidélité des
barons et des communes ; Marseille, Aix et Arles refusèrent
de le prêter. Charles résolut de se venger. Après
trois mois de séjour à Aix, il emmena Béatrix en France.
Là, son orgueil toujours grandissant le rendit insupportable.
Dans ce voyage, fut décidée la croisade pour la délivrance
des Lieux Saints, à laquelle prirent part le roi de
France, Charles d'Anjou et les deux soeurs, Marguerite et
Béatrix de Provence, leurs épouses. Charles Ier d'Anjou, qui avait connu la douce Béatrix à
la Cour de son frère Louis IX, avait voulu gagner, par
une conduite noble et courageuse, ses grâces et son
amitié; il vint à différentes reprises, avec une suite nombreuse, au château de Saint-Maime, déposer à ses pieds
son nom, sa gloire et sa couronne comtale.
La tradition nous apprend que le château où il venait
présenter à Béatrix ses gracieux hommages était trop
exigu et ne pouvait contenir que peu de monde ; aussi le
comte d'Anjou ne dédaignait pas de passer les nuits, avec
les gens de sa suite, dans le grenier à foin d'une grange
voisine.
On raconte même qu'il eut à essuyer une attaque
nocturne de la part d'une bande de truands armés, venus
des forêts environnantes, à laquelle s'étaient joints les
habitants d'un proche village.
Ces bandits cachaient leurs projets de meurtre et de
pillage sous le dehors d'une expédition politique et
déclaraient bien haut qu'ils ne voulaient aucune alliance
avec la couronne de France et que l'union de Charles et
de Béatrix amènerait, par l'unité française, la fin de la
nationalité provençale.
Charles d'Anjou, qui veillait près du manoir féodal et vigoureusement secondé par les gens d'alentour, déploya,
en cette circonstance, des prodiges de valeur ; les assaillants, partisans des Aragonais, dont le chef était un
seigneur provençal de médiocre fortune, furent repoussés.
Mais l'assaut avait répandu la terreur dans cette résidence
comtale, et Béatrix, seule dans la tourelle du donjon,
sentait son coeur frémir d'une légitime angoisse ; déjà, ses
dames d'honneur s'étaient empressées autour d'elle,
lorsque soudain un cliquetis d'armes se fit entendre au
pied de la forteresse et deux hommes masqués, enveloppés
de larges manteaux noirs, après avoir tué la sentinelle,
courent sur Béatrix et l'enlèvent ; mais Charles d'Anjou,
qui avait deviné leur sinistre dessein, franchit le pont-levis,
pénètre dans la cour et, la dague nue au poing,
suivi de quelques archers, s'élance à leur poursuite et, les
atteignant, perce de son glaive le sein du ravisseur.
Béatrix était sauvée ! Aussi, deux fois vainqueur dans la
même journée, cet éclatant succès décida Béatrix à lui
accorder sa main. Alors les chants d'allégresse firent
taire les bruits du tocsin ; le joyeux carillon de la chapelle
du manoir appela le peuple à célébrer sa gloire, et, ce jour là,
on vit les habitants de Saint-Maime et de Dauphin
danser au son des fifres et des tambourins.
Les nobles provençaux étaient, pour la plupart, défavorables
aux visées de Charles d'Anjou, et déjà les troubadours
annonçaient la prochaine déchéance de la Provence.
Ayméric de Péguilhan, qui écrivait, à la Cour de Béatrix,
les Angoisses d'Amour, chantait des coblats contre
Charles d'Anjou à l'occasion de son mariage avec Béatrix :
« Au lieu d'un brave seigneur, les Provençaux, dit-il,
auront un maître. Subjugués par les Français, ils n'oseront
plus porter contre eux ni lance, ni écu. Puissent-ils être
tous morts plutôt que de se voir réduits en cet état ! Mais
ils le méritent par leur infidélité envers celui qui pouvait
les en garantir ! »
Au contraire, le troubadour Bertrand de Lamanon déploya autant d'ardeur à soutenir Charles d'Anjou que
Péguilhan en mit à l'attaquer. Il lui adressa un sirventès
pour l'exhorter à ne pas laisser enlever Béatrix par
Aragon ou par Toulouse : « Venez sans délai, lui disait-il ;
si un fils d'un roi de France se laisse dépouiller par ses
voisins, comment ferait-il des conquêtes d'outre-mer ? »
Mais Bertrand de Lamanon, désabusé du parti angevin,
rima plus tard contre Charles II et fut dépouillé par ce
prnice de la gabelle de Pertuis, qu'il possédait héréditairement.
Charles d'Anjou aima Béatrix avec la passion ardente,
sérieuse et chevaleresque de ces temps de fidélité.
Mais aux jours de bonheur succédèrent des heures
sombres, car les trois soeurs aînées de Béatrix, qui étaient
reines, la faisaient asseoir, quelquefois, sur un escabeau,
à leurs pieds. Celle-ci, humiliée, irritait quelque peu l'âme
jalouse et violente de son mari : il fallait aussi un trône
à elle et à n'importe quel prix !
Un manuscrit du XVIIIe siècle, traduit par Lecoy de la
Marche, explique la raison pour laquelle Charles d'Anjou
voulut être roi de Sicile.
Les quatre filles de Raymond-Bérenger devaient dîner
ensemble, lorsque, suivant l'usage, elles furent se laver
les mains ; les trois aînées s'y rendirent de compagnie,
mais n'appelèrent point avec elles leur plus jeune soeur,
Béatrix. « Il ne sied point, dirent-elles, qu'une simple
comtesse se lave avec des reines. »
Le propos lui ayant été rapporté, celle-ci en conçut un
violent dépit. Le soir, se trouvant seule avec son mari,
elle se mit à pleurer. Il lui demanda la cause de ce
chagrin ; elle lui raconta tout. Alors Charles lui dit
tendrement : » Ne te désole pas, ma douce amie ; à partir
de ce soir, je n'aurai pas un moment de repos que je n'aie
fait de toi une reine, comme tes soeurs aînées. »
La gracieuse comtesse Béatrix, qui désirait ardemment
être reine, adopta avec enthousiasme le projet d'une
expédition à Naples. Elle intéressa à sa cause les troubadours et les gentes
dames ses amies, qui, à cette époque galante, ordonnaient
souverainement aux nobles hommes et chevaliers la
conduite qu'ils devaient tenir pour mériter leurs sourires
et leurs louanges.
Au palais de la comtesse de Provence, s'assemblèrent
extraordinairement en hiver les dames des Cours d'amour
de Signes, de Pierrefeu, et celles de la Cour suprême
de Romanil, qui avaient coutume de tenir leurs poétiques
assises dans les premiers jours des calendes de mai.
Au cry de la comtesse proclamé par ses messagers, de
toutes les châtellenies de Provence, du Languedoc, etc.,
troubadours, ménestrels, faiseurs de sirventès, joueurs de
guitare et gentes dames accoururent, celles-ci montées
sur haquenées ou palefrois, en carruques d'osier attelées
à des mules ou traînées par des roussins. Au lieu des
subtiles questions d'amour ou des tensons habituels, on
entendit, à cette Cour, des chants de vaillance. Là,
Blacasset de Blacas dit son poème sur la guerre qui fait
briller la générosité des grands et prospérer les braves.
On applaudit Gasbert de Puycibol, qui brûlait de
combattre pour mériter l'anneau ou le lacet de Barasse
de Barras ; Pierre de Saint-Rémy, que son zèle à s'illustrer
pour sa dame rendit un des plus glorieux chevaliers
de Charles d'Anjou ; Aymeric de Péguilhan, qui écrivit les
Angoisses d'Amour ; Richard de Noves, Boniface de
Castellane et tous autres servans d'amour.
L'entraînement fut général.
Au mois de février 1264, le peuple fut convoqué à
s'assembler devant le palais comtal d'Aix. La foule était
immense. Charles d'Anjou, Béatrix, entourés de Vicedominus,
archevêque d'Aix, de l'archevêque d'Arles, des
évêques provençaux et des principaux seigneurs de la
province, parurent au balcon de la façade du palais.
Le cardinal de Brie, légat du Pape, déclara hautement
que le Pape Clément IV avait conféré au comte de Provence le royaume des Deux-Siciles et il s'écria : « Vive
et gloire à Charles et à Béatrix, roi et reine des Deux-
Siciles ! »
Le peuple répondit par de longues acclamations, et tout
aussitôt les apprêts de l'expédition commencèrent.
La ville d'Aix fit présent au roi de la somme considérable
de vingt mille florins d'or. Les dames de la Cour,
imitant la comtesse Béatrix, vendirent leurs bijoux pour
subvenir aux frais de la guerre. Après la victoire de
Bénévent, où périt Mainfroy, roi des Deux-Siciles, Charles
d'Anjou devint le maître de ces royaumes.
Il fut couronné, avec Béatrix, à Rome, le 6 janvier
1266 (1).
(1) Provence et Naples, par M. le marquis de Gantelmi d'Ille. — Aix, 1906.
Charles Ier d'Anjou était avide d'acquérir des terres, des
seigneuries et d'avoir d'argent pour fournir à ses entreprises
ambitieuses ; jamais il ne prit plaisirs aux réunions
des troubadours et aux fêtes de la Cour. Il fut le démon
tentateur du roi de France et fut surnommé l'homme noir :
il abusa d'une fortune immense, car, cadet de France, il
était devenu le prince le plus puissant de la chétienté :
possesseur du royaume des Deux-Siciles, titulaire de ceux
d'Arles, de Vienne et de Jérusalem, prince d'Achaïe, comte
d'Anjou, de Provence et de Forcalquier, protecteur des
Flandres, il avait déjà conquis en partie et restauré, à son
profit l'empire grec d'Orient, quand la fortune l'abandonna.
Une réaction terrible se produisit contre sa domination
souveraine ; le peuple se souleva et, lors des Vêpres Siciliennes,
massacra les Français, épargnant les Provençaux,
qui avaient su se rendre populaires. Les flottes de Charles
furent dispersées ou anéanties (1282, lundi de Pâques).
Il avait trompé la pieuse simplicité de son frère, saint
Louis, roi de France, pour détourner la huitième et dernière croisade, de son but : celui de mettre le pied en
Afrique et rendre Tunis tributaire. Il revint le premier de
cette expédition, faite par ses conseils et pour lui : il se
trouva à temps pour profiter de la tempête qui brisa les
vaisseaux des croisés, pour saisir les dépouilles, sur les
rochers de Calabre, les armes, les habits, les provisions et
s'attribuer le droit de bris, qui donnait au seigneur de
l'écueil tout ce que la mer lui jetait.
Ce prince, malgré son caractère farouche, fut sage et
prudent dans les conseils, preux dans les armes, sévère et
fort redouté des rois ; malheureusement, il se signala par
ses exactions et en détruisant les dernières républiques
provençales.
L'ambition de Charles d'Anjou était sans limite, comme
son audace et son orgueil, secondés par une rare intelligence
et une grande bravoure. Quand il eut soumis à ses
dures lois villes, barons et gentilshommes, il voulut
étendre sa domination. Il revendiqua les droits qu'il prétendait
avoir sur la république d'Avignon, exigea l'hommage
de Guillaume des Baux et se fit céder par lui le titre
de roi d'Arles et de Vienne, puis il contesta à l'empereur
d'Allemagne sa suzeraineté sur Lurs et la Provence.
Béatrix souffrit beaucoup de la politique altière de son
mari.
Cependant Charles d'Anjou s'était entouré de négociateurs
capables de seconder ses desseins ; mais, malgré ses
habiles négociations, la maison d'Anjou resta fatale à la
Provence par le mauvais gouvernement de ses princes,
qui, d'ailleurs, résidèrent presque toujours à Naples, et
par les désastreuses guerres d'Italie et d'Aragon, qu'ils
occasionnèrent. Charles 1er d'Anjou, par la hauteur de son
caractère, la cruauté de ses moyens pour imposer sa
volonté, a mérité la sévérité de l'histoire dernière croisade, de son but : celui de mettre le pied en
Afrique et rendre Tunis tributaire. Il revint le premier de
cette expédition, faite par ses conseils et pour lui : il se
trouva à temps pour profiter de la tempête qui brisa les
vaisseaux des croisés, pour saisir les dépouilles, sur les
rochers de Calabre, les armes, les habits, les provisions et
s'attribuer le droit de bris, qui donnait au seigneur de
l'écueil tout ce que la mer lui jetait.
Ce prince, malgré son caractère farouche, fut sage et
prudent dans les conseils, preux dans les armes, sévère et
fort redouté des rois ; malheureusement, il se signala par
ses exactions et en détruisant les dernières républiques
provençales.
L'ambition de Charles d'Anjou était sans limite, comme
son audace et son orgueil, secondés par une rare intelligence
et une grande bravoure. Quand il eut soumis à ses
dures lois villes, barons et gentilshommes, il voulut
étendre sa domination. Il revendiqua les droits qu'il prétendait
avoir sur la république d'Avignon, exigea l'hommage
de Guillaume des Baux et se fit céder par lui le titre
de roi d'Arles et de Vienne, puis il contesta à l'empereur
d'Allemagne sa suzeraineté sur Lurs et la Provence.
Béatrix souffrit beaucoup de la politique altière de son
mari.
Cependant Charles d'Anjou s'était entouré de négociateurs
capables de seconder ses desseins ; mais, malgré ses
habiles négociations, la maison d'Anjou resta fatale à la
Provence par le mauvais gouvernement de ses princes,
qui, d'ailleurs, résidèrent presque toujours à Naples, et
par les désastreuses guerres d'Italie et d'Aragon, qu'ils
occasionnèrent. Charles 1er d'Anjou, par la hauteur de son
caractère, la cruauté de ses moyens pour imposer sa
volonté, a mérité la sévérité de l'histoire (1),
(1) M. le marquis de Gantelmi d'Ille, Provence et Naples. — Aix, P. Jourdan, 1906
Il frappa une monnaie en argent, de 1249 à 1277, à
Forcalquier, appelée « demi-forcalquièros ».
Sous son règue, on construisit, en cette ville, la façade
et le choeur de l'église des Cordeliers, et Béatrix abandonna
aux Hospitaliers les droits qu'elle possédait à
Manosque et dans sa vallée.
En 1265, Béatrix était enceinte et si souffrante que l'on
craignait pour sa vie. Elle vit en songe une dame portant
l'habit religieux des Béguines, qui la visitait, priait pour
elle et obtenait sa guérison. Charles 1er d'Anjou fit venir
à Aix, de Digne, une fille du nom de Douceline, qui possédait
d'admirables vertus, une grande humilité et était fort
charitable.
Dès que Béatrix la vit, elle reconnut en elle la dame qui
lui avait apparue. Elle obtint, par les prières de Douceline,
une fille, que celle-ci eut l'honneur de tenir sur les fonts
baptismaux. (G. de Rey.)
Cette fille épousa le jeune Philippe, prétendant latin de
Constantinople ; son fils, le prince de Salernes, Charles II
le Boiteux, qui fut fait prisonnier par les Aragonais, en
1284, et rendu à la liberté après une rançon considérable,
devint, en 1286, comte de Provence et de Forcalquier.
Béatrix mourut bien jeune encore, à Nocera, en 1266.
Par testament, elle avait déclaré qu'elle désirait avoir sa
sépulture dans l'église Saint-Jean de Malte, à Aix, aux
côtés de ses parents et de son aïeul ; mais son mari la fit
ensevelir dans une église, à Naples, au mépris de ses
dernières et suprêmes volontés.
Les Provençaux protestèrent hautement et prièrent
Feraud de Barras, grand prieur des Hospitaliers, de présenter
leurs plaintes au pape Clément IV. Sur les instances
de ce dernier, le roi Charles fit transporter à Aix les
restes mortels de la reine de Naples, qui fut inhumée aux
côtés d'Alphonse II, son grand-père, et de Raymond-
Bérenger IV.
Ces tombeaux furent détruits sous la Terreur. A l'époque de la Restauration, le comte de Villeneuve-
Bargemon, préfet des Bouches-du-Rhône, ouvrit une
souscription pour les rétablir.
Le roi Charles X s'inscrivit en tête, et la Provence offrit,
à la mémoire de ses plus illlustres souverains, une éclatante
réparation.
Ce monument fut rétabli le 12 novembre 1826, sur les
dessins des tombeaux primitifs, mais celui de Béatrix ne
l"a pas été ; on s'est contenté d'unir son nom à celui de ses
parents.
M. Eugène Plauchud a dit de Béatrix, l'héroïne de son
patriotique poème : Lou Diamant de Sant-Maïme : "De diamant ! N'i-a ren qu'un dedins nouosto encountrado,
Lou diamant de Sant-Maïme. Ou castèu ei soun nis.
De Prouvenço n'en fai no terro ben astrado,
Soun trelus de partout s'alargo et s'espargis." Les filles de Raymond-Bérenger IV, ces illustres princesses,
toutes reines à la fois, firent briller sur les trônes
des rois de France, d'Angleterre, des Romains et de
Naples le sentiment poétique, l'amour des lettres et des
arts, le charme, les grâces et la beauté dont notre Provence,
de tout temps, a si richementsu doter ses enfants.
Charles Ier d'Anjou mourut à Foggia, en Pouille, le
7 janvier 1285, avec la piété et la sécurité d'un saint,
chargeant le roi de France d'administrer provisoirement
ses Etats.
Une rue de Forcalquier porte le nom de Bérenger. Cet
hommage au bienfaiteur de cette ville est bien insuffisant.
L'idée fut émise, en 1854, d'élever une statue au comte
Raymond-BérengerIV.
Souhaitons qu'un jour un monument s'élève, au
milieu d'une place publique, pour honorer sa mémoire et que, sur les quatre faces du piédestal, soient sculptés les
médaillons des quatre reines, filles du glorieux comte de
Provence et de Forcalquier (1).
(1) M. E. Plauchud, dans la séance annuelle de l'Athénée de Forcalquier du 8 novembre 1891, émettant la généreuse idée de creuser un grand bassin, en aval de la petite fontaine qui coule près la chapelle de Saint-Marc, pour l'alimentation estivale des fontaines publiques, disait : « Avec ce grand réservoir convenablement installé et qui servirait en même temps de bassin d'épuration,plus d'eau trouble aux jours de pluie, des masses d'eau en cas d'incendie, en ouvrant la vanne du fond, des bornes-fontaines partout où le besoin se fait sentir et de l'eau à profusion pour la fontaine artistique qu'un jour on élèvera, au milieu du Bourguet, à notre grand Bérenger et à ses quatre filles. » Et lorsque les importants travaux de captage et d'adduction d'eau pour augmenter le débit des fontaines publiques auront reçu une heureuse solution, que l'on aura créé des bornes-fontaines pour desservir les hauts quartiers du pays, que les rues recevront une abondante provision d'eau pour faciliter le service et les exigences de l'hygiène, que les maisons particulières seront alimentées à tous les étages, les Forcalquiérens se rappelleront que l'initiative de cette amélioration essentielle, qui ouvre une ère de bien-être et de prospérité à leur ville, est due à leur concitoyen, M. Eugène Plauchud, Le plan de ces travaux fut exécuté par M. Léopold Vautrin, conducteur des ponts et chaussées, sous la direction de M. Charles Aragnol, ingénieur. pendant l'administration de MM. Martial Sicard, ancien député, maire, Cyprien Bernard, premier adjoint, et Fernand Bonniol, deuxième adjoint.
Cette notice relève certaines particularités qui ont, en partie, échappé aux annalistes provençaux. Le séjour des anciens comtes de Forcalquier au château de Saint-Maime est indiscutable, car, outre les imposants vestiges qui existent encore, la tradition a su recueillir religieusement des faits précieux, et les noms que conservent plusieurs quartiers de ce lieu donnent une signification et une portée qui ne sauraient être douteuses. Au bas même de la colline qui porte les ruines duchâteau féodal, on montre : la Vigne de la Cour, le Pré de la Cour, et un chétif enclos est dénommé le Jardin de la Cour. Il était de notre devoir de donner la preuve de nos assertions et, à ce sujet, de faire des recherches dans les archives municipales de Saint-Maime et de compléter cette étude par des pièces justificatives, lorsque nous apprîmes que les anciens papiers et parchemins qui auraient pu guider nos recherches et faire la lumière sur ce point obscur, de notre histoire locale étaient jadis enfermés dans un superbe coffre en bois et avaient été brûlés entièrement, vers 1853, par un instituteur maladroit ou inconscient, qui, sans doute, ne se rendit pas compte de l'acte de vandalisme qu'il commettait ! Ainsi, de ces événements historiques, il ne nous reste que de bien lointains souvenirs, relatés succinctement par les historiens provençaux et par nos annalistes, événements qui, peut-être, seront oubliés un jour, car aucun monument ne les rappelle, aucune inscription ne les consacre. Puisse cette étude, modeste soit-elle, les préserver de l'oubli !
CYPRIEN BERNARD
![]()
Par l'auteur du site : J.P. Audibert